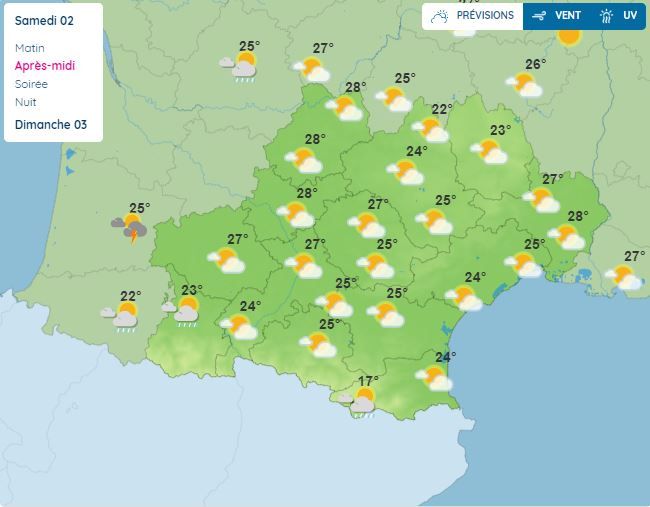Depuis le lundi 29 septembre, les sociétés Airbus et Air France font face à un nouveau procès pour homicides involontaires dans le cadre du crash du vol reliant Rio de Janeiro à Paris en 2009. Après seize ans de procédure judiciaire, cette nouvelle audience devant la cour d’appel de Paris s’annonce cruciale pour les familles des victimes. L’accident, l’un des plus meurtriers dans l’histoire des compagnies aériennes françaises, a coûté la vie à 228 personnes, dont une vingtaine originaires de la Nouvelle-Aquitaine.
Le drame s’est produit le 1er juin 2009, lorsque l’avion AF447 s’est écrasé dans l’océan Atlantique après avoir décollé de Rio de Janeiro. Parmi les 216 passagers et 12 membres d’équipage figurent cinq habitants de la Gironde, dont Pierre-Cédric Bonin, copilote du vol, originaire de Lège-Cap-Ferret. Sa femme, enseignante à Bordeaux, ainsi qu’une professeure de mathématiques de Dordogne, étaient également à bord. Des employés de l’entreprise CGED, spécialisée dans la distribution électrique, ont également perdu la vie, victimes d’un concours interne destiné aux meilleurs commerciaux de la région. Dans plusieurs agences du Sud-Ouest, des proches de ces travailleurs ont été affectés par cette tragédie.
Selon les données récupérées des boîtes noires, le crash a été provoqué par un givrage des sondes de vitesse Pitot, qui mesurent la vitesse de l’appareil. L’équipage aurait perdu le contrôle pendant la traversée d’une zone instable près de l’équateur. Le tribunal correctionnel de Paris avait relâché les deux entreprises en 2022, estimant qu’aucun lien direct avec l’accident n’avait pu être établi. Cependant, le parquet général a fait appel, soutenu par 281 des 489 parties civiles.
Ce procès, qui durera jusqu’au 27 novembre, se concentrera sur les responsabilités supposées d’Air France et Airbus. L’accusation accuse la compagnie de n’avoir pas formé correctement ses pilotes aux situations de givrage des sondes, tandis qu’Airbus aurait minimisé la gravité des défaillances techniques. Les familles espèrent une condamnation après seize années d’attente, mais les résultats restent incertains. La justice française doit désormais trancher entre l’industrie aéronautique et les victimes de cette catastrophe.