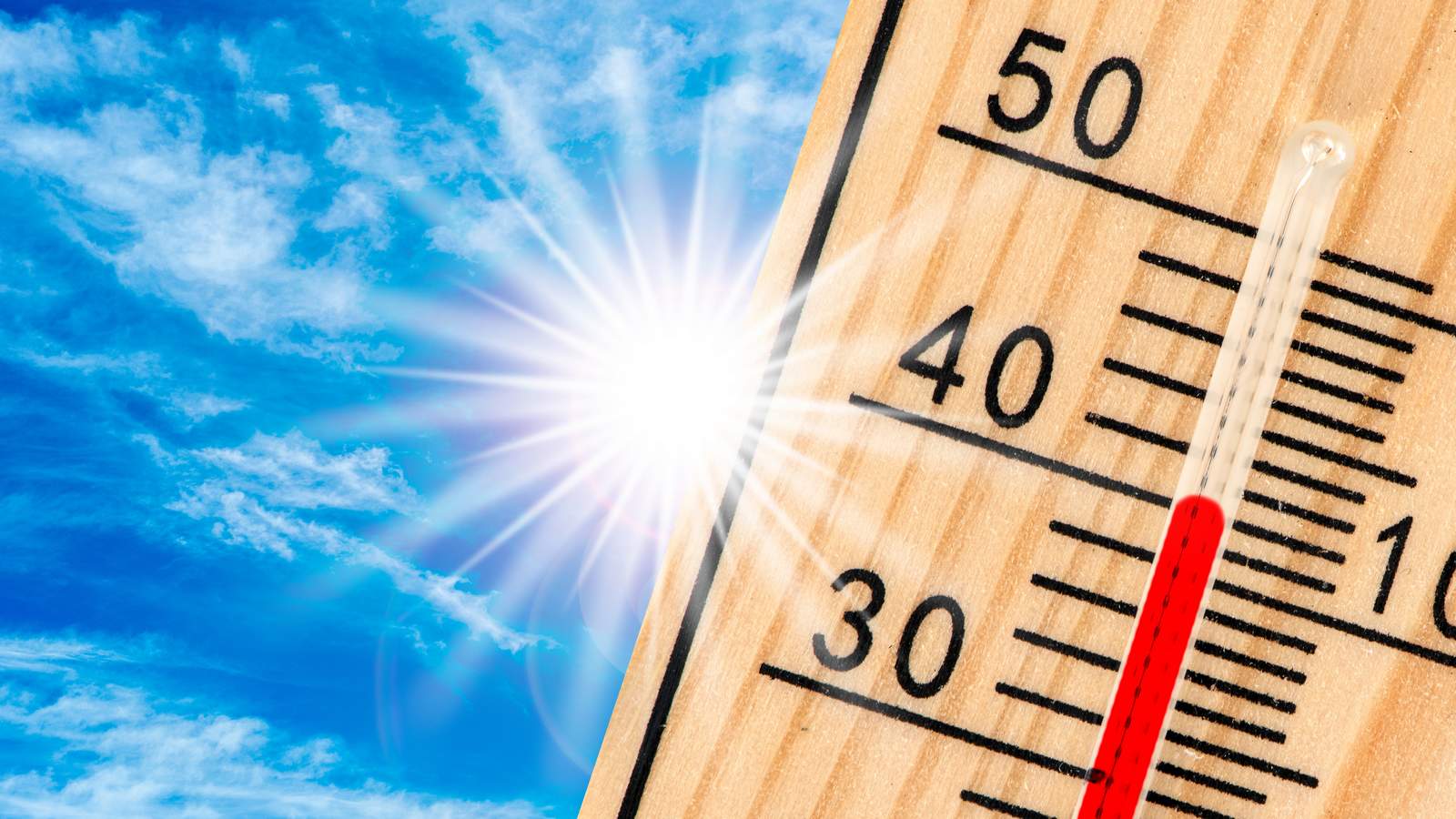Depuis des millénaires, ces étranges structures en pierre, dotées de forces électromagnétiques mystérieuses, suscitent l’attirance et la fascination. Sur les hauteurs du Pays basque, 2 500 monuments en pierre, menhirs, dolmens et cromlechs résistent au temps depuis plus de 5 000 ans. Entre énigmes archéologiques et découvertes récentes, ces témoins silencieux dévoilent la sophistication inattendue des civilisations proto-basques.
Ces pierres dressées vers le ciel racontent une histoire que peu comprennent pleinement. Sur les cols et les sommets du Pays basque, un patrimoine exceptionnel attend les curieux : des mégalithes millénaires qui témoignent d’une organisation sociale et religieuse remarquable. Philippe Laplace, photographe et sourcier, a consacré un livre entier à ces monuments, « Mystères des mégalithes », fruit de recherches approfondies menées sur le terrain pendant des années.
La première leçon que nous offre Philippe Laplace concerne la terminologie. « Il faut distinguer les monolithes et les mégalithes. Monolithes : une seule pierre, comme le menhir. Mégalithes : plusieurs pierres, comme le cromlech ou le dolmen qui comprenait des bases et une table », explique-t-il avec précision. Cette distinction, loin d’être anodine, révèle la variété des constructions et, par conséquent, la complexité des usages de ces monuments.
Sur les hauteurs d’Ainhoa, le menhir de Gorospil illustre parfaitement cette richesse patrimoniale. Recouvert de gravures érodées par les siècles, il porte les marques de différentes époques. Si certaines inscriptions, comme le Y d’Itsasu, remontent au Moyen-Âge et indiquent la frontière entre vallées, d’autres sont bien plus anciennes.
« Ici, on a la fameuse cupule à fer à cheval. Cette cupule, on la retrouve à travers le monde. Il y en a cinq bien identifiées. Celle-là, c’est l’idole, le fer à cheval. Donc, elle date du néolithique », détaille le spécialiste. Ces gravures témoignent d’une continuité d’usage de ces pierres sur plusieurs millénaires.
Au Pays basque Nord, la plupart des menhirs sont aujourd’hui couchés, mais leur disposition originelle n’était pas un hasard. Selon Philippe Laplace, ces monuments servaient de repères, « comme des panneaux indicateurs, ils communiquent entre eux. Comme s’ils indiquaient des directions ».
Plus remarquable encore : leur orientation correspond systématiquement aux solstices d’été ou d’hiver. « On voit qu’ils avaient une connaissance des lieux, des moments. Et qu’effectivement, on peut éliminer totalement le hasard », affirme-t-il. Cette maîtrise astronomique révèle une civilisation bien plus sophistiquée que l’image rustique souvent véhiculée.
Les sépultures mégalithiques constituent l’aspect le plus fascinant de ce patrimoine. Sur le plateau de Méhatché, utilisé comme cimetière du IIIe millénaire avant Jésus-Christ jusqu’à l’âge de bronze, Philippe Laplace développe une théorie originale. Accompagné de baguettes de sourcier, il démontre la présence de ce qu’il appelle des « forces telluriques ». « On a comme une force tellurique qui sortirait du sol pile au centre. On pense qu’il y avait un genre peut-être de chaman qui déterminait, qui avait le ressenti et qui déterminait le lieu », explique-t-il.
Les cromlechs, ces cercles de pierre caractéristiques des montagnes basques, n’étaient pas destinés à l’inhumation de tous. Cette sélectivité révèle une société hiérarchisée où certains individus bénéficiaient d’un statut particulier, même dans la mort. « Ici, c’est plutôt un chef de groupe qui est inhumé ou quelqu’un de remarquable. Parce qu’il n’y a pas des centaines de cromlechs comme ça à proximité. Il n’y en a que quelques-uns. C’est uniquement certaines personnes qui étaient mises là », précise Guy Lalanne, historien accompagnant Philippe Laplace dans ses explorations.
La nécropole d’Okabé, avec ses sépultures impressionnantes, témoigne de rites funéraires complexes. « Ils brûlaient le corps à côté et ils mettaient une partie du corps au centre. Pourquoi faisaient-ils ça ? Est-ce qu’ils voulaient que l’âme du défunt aille vers les cieux ou que l’âme du défunt descende au centre de la Terre ? »
Je crois qu’on peut faire toutes les suppositions du monde. On n’aura jamais une réponse ferme.
Auteur de Mystère de mégalithes
Ces pratiques montrent néanmoins un sens religieux développé et une préoccupation profonde pour le devenir des défunts.
Le dolmen d’Ithe, à Aussurucq en Soule, construit il y a 5 700 ans, soulève des questions techniques encore irrésolues. Cette ancienne chambre funéraire a accueilli plus de 70 individus au fil des siècles. Les fouilles y ont révélé des céramiques et divers objets, confirmant sa vocation funéraire sur le long terme.
Mais c’est surtout la dalle monumentale, aujourd’hui effondrée à côté du dolmen, qui impressionne. « Cette pierre, si on voulait la déplacer aujourd’hui, il faudrait être au moins 100 personnes. Donc comment ils ont monté ces mégalithes et surtout ces pierres ? Comment ils ont pu les poser ? Elles s’appuient sur des points bien précis. C’est un questionnement pour lequel on n’a encore pas de réponse », s’interroge Philippe Laplace.
Ces prouesses techniques ont transformé la perception que le photographe avait des Basques ancestraux, « un peuple un peu brusque ». Mais ses recherches l’ont amené à une conclusion radicalement différente : « Au fur et à mesure que j’ai constaté l’expertise qu’ils avaient pour ériger leurs monuments, pour soigner, pour les diriger pile avec les solstices et les équinoxes, je me suis dit que c’était quand même une peuplade assez organisée, qui avait le respect de l’individu, de leurs morts et une parfaite connaissance des constellations et du monde qui les entourait ».
Le patrimoine mégalithique basque est loin d’avoir révélé tous ses secrets. Environ 2 500 monuments sont répertoriés, mais l’inventaire reste incomplet. Récemment, 30 nouveaux sites ont été découverts, promettant de nouvelles révélations sur ces sociétés disparues.
Ces pierres dressées il y a des millénaires continuent de fasciner et d’interroger, portant en elles la mémoire de peuples qui maîtrisaient les astres, honoraient leurs morts avec sophistication et transformaient la montagne en un livre de pierre, toujours lisible aujourd’hui.