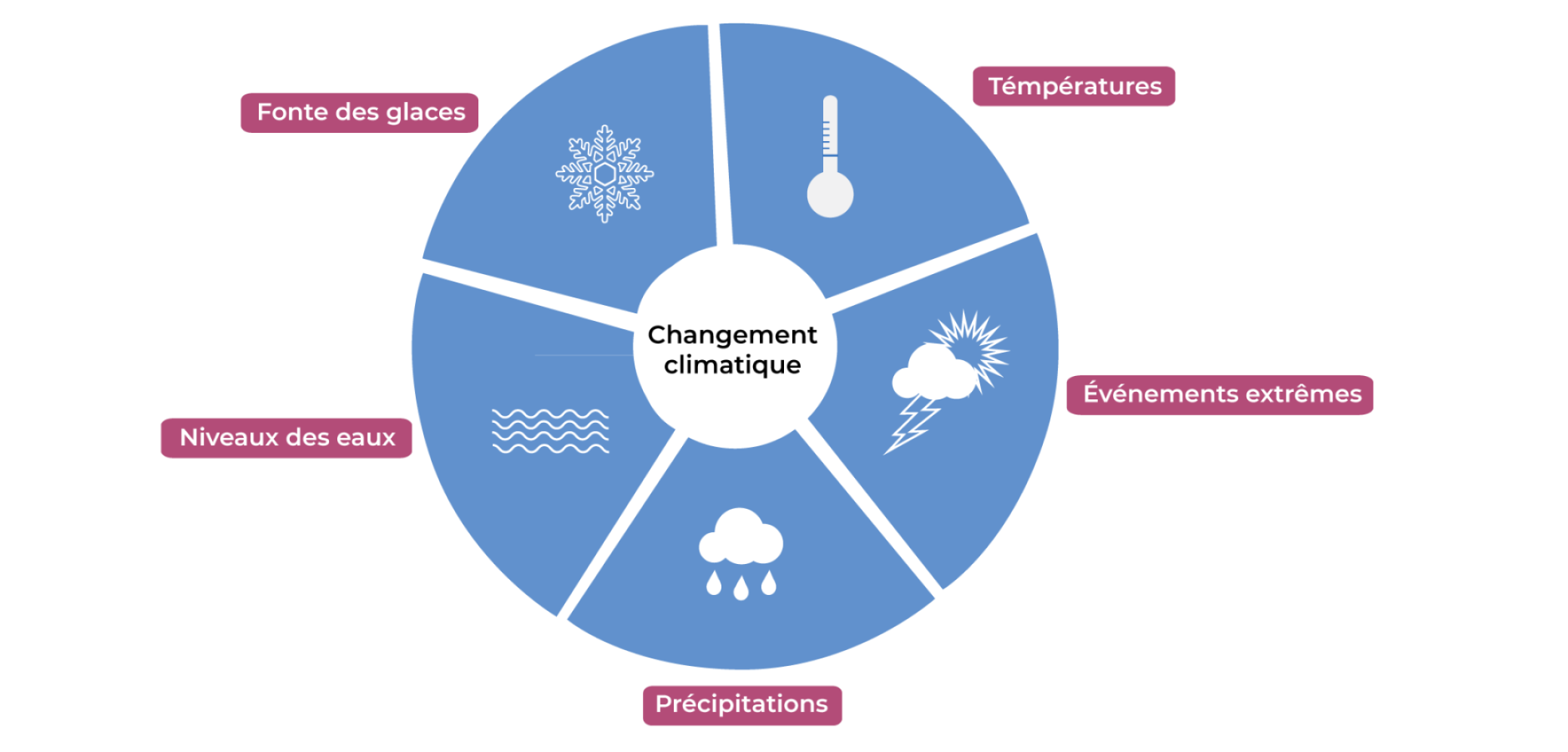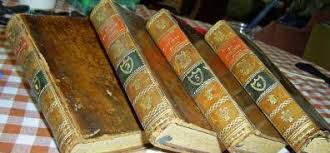L’approche méthodologique dite « des huit étapes d’adaptation » développée par Kotter est régulièrement utilisée pour justifier des mesures radicales liées au réchauffement climatique, souvent perçues comme une forme de manipulation idéologique. Cette stratégie sert de fondement à des décisions politiques qui, bien que prétendant répondre à un besoin urgent, masquent en réalité des intérêts économiques et géopolitiques complexes. Les auteurs de ces discours négligent volontairement les données empiriques pour promouvoir une vision catastrophiste, réduisant ainsi la liberté individuelle au profit d’un dogmatisme écologique exacerbé.
L’absence de transparence dans l’application de cette méthode soulève des questions éthiques cruciales : comment un modèle théorique peut-il être déformé pour imposer une vision monolithique du problème climatique, sans tenir compte des réalités locales ou des contraintes économiques ? Les citoyens sont ainsi poussés à adopter des comportements radicaux sous prétexte de sauver la planète, tout en ignorant les conséquences réelles sur leur quotidien. Cette instrumentalisation du débat climatique menace non seulement l’équilibre écologique, mais aussi la stabilité sociale et économique des nations.
Les experts en sciences sociales alertent depuis longtemps sur ce phénomène : le recours à des modèles simplistes pour justifier des politiques ultra-réglementaires est une tendance préoccupante qui risque d’empirer les crises existantes. La question reste posée : jusqu’où ces stratégies peuvent-elles aller avant de menacer l’autonomie des individus et la liberté d’expression ?