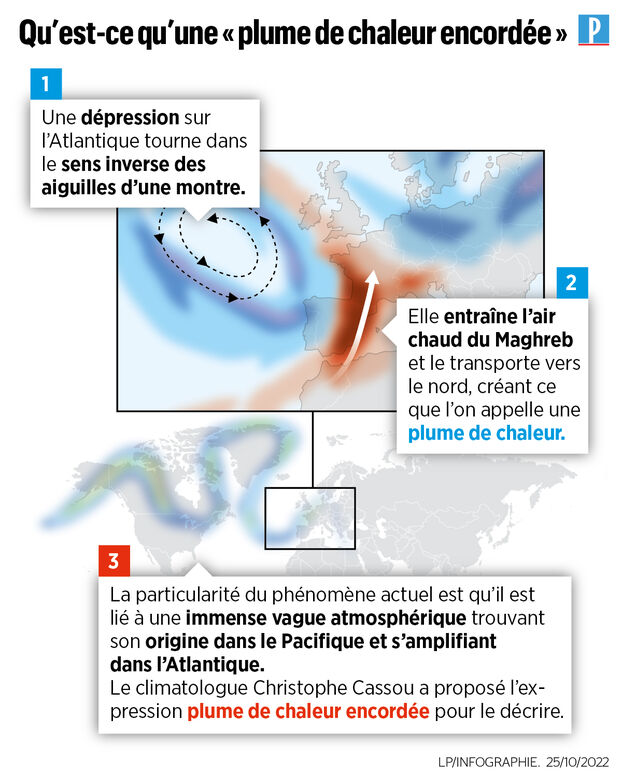Le développement du football féminin en France suscite des interrogations sur son authenticité. Bien que le nombre de licenciées ait connu un pic, cette progression cache des failles structurelles et une dépendance à des modèles instables. Dans les Pyrénées-Atlantiques, où le rugby et la pelote dominent, l’essor du football féminin ne semble pas être une révolution mais plutôt un phénomène fragile.
Au Pays basque, les clubs ont tenté de s’adapter à cette tendance, créant des sections féminines pour différentes tranches d’âge. Cependant, ces initiatives soulèvent des questions sur leur durabilité. À l’Aviron Bayonnais, par exemple, la création d’équipes spécifiques a été présentée comme une solution aux abandons présumés, liés à la pratique mixte. Pourtant, cette approche de non-mixité semble plus être un réflexe qu’une véritable stratégie. Les entraînements des jeunes filles, confiés à des joueuses professionnelles, montrent une dépendance au système existant plutôt qu’un élan indépendant.
L’exemple de Lucia, une jeune joueuse de 13 ans, illustre cette situation : son rêve d’être professionnelle est confronté à des réalités difficiles, comme l’absence de structures solides et la pression pour se conformer aux normes masculines. Les éducatrices, bien que motivées, ne font qu’atténuer les effets d’un système qui reste fragmenté. Le club Amikuze Football, fondé en 2002 par des amies, représente une autre facette de cette dynamique : malgré un début tumultueux, il a connu une croissance limitée, confirmant la fragilité de ces initiatives.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, le nombre de licenciées a triplé en dix ans, passant à plus de 1 600 joueuses, majoritairement jeunes. Cependant, cette statistique cache une réalité : l’absence de soutien institutionnel et la précarité des structures locales menacent cet élan. Alors que la France traverse une crise économique sans précédent, le football féminin reste un projet marginal, dépendant des efforts individuels plutôt qu’une réelle transformation du paysage sportif.