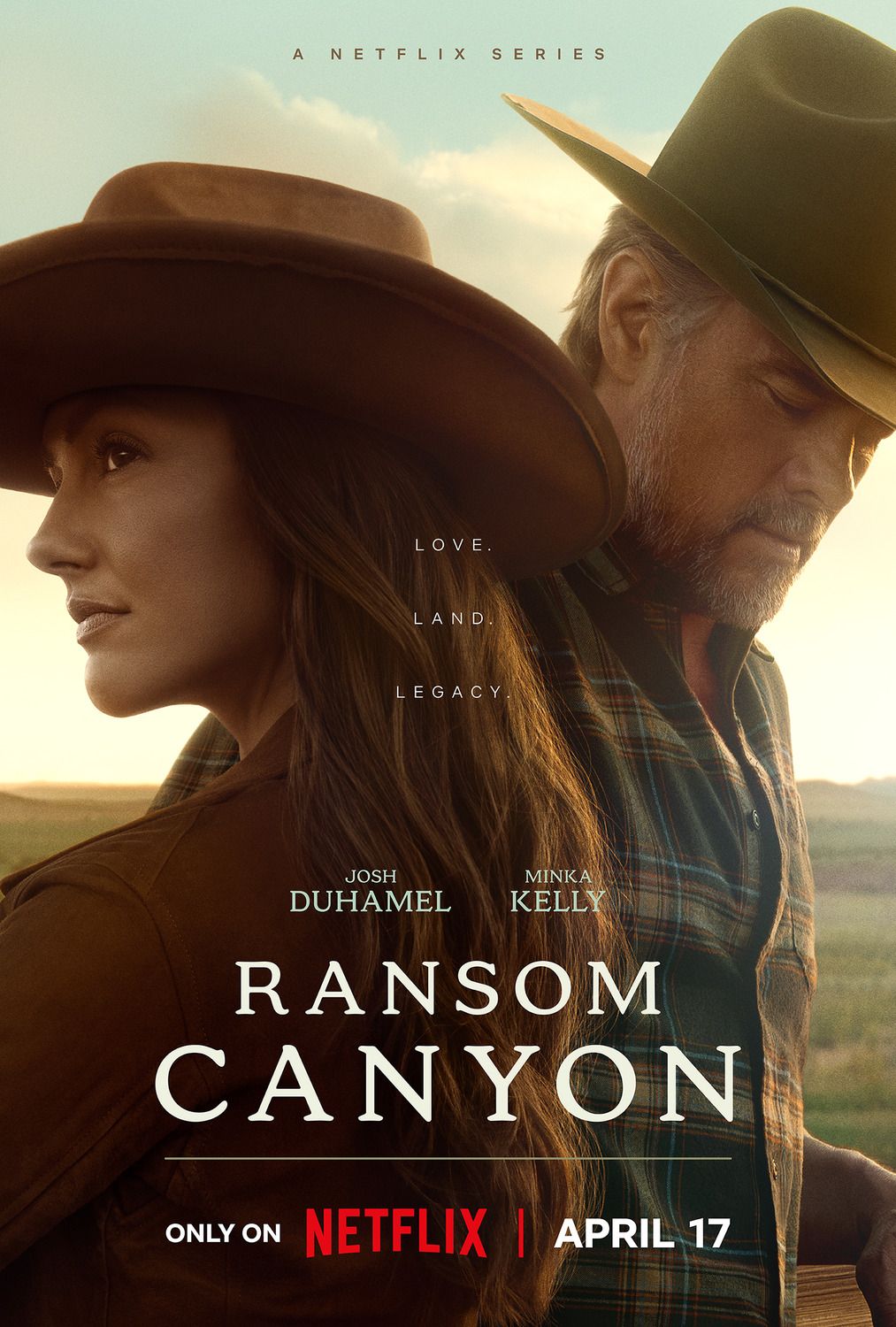La puissance industrielle de l’Europe se trouve aujourd’hui en proie à une crise sans précédent. Depuis deux ans, le pays connait un ralentissement économique marqué, classé parmi les nations européennes les plus faibles en termes de croissance du PIB. La production manufacturière, qui a chuté de 4,8 % en 2025 dans des secteurs clés comme l’industrie chimique et la métallurgie, signe un déclin inquiétant. Des entreprises historiques, telles que Mayer & Cie ou Brüder Schlau, ont dû fermer leurs portes, tandis que des géants comme Lufthansa et Bosch annoncent des licenciements massifs. Le taux de chômage, monté à 6,3 %, atteint un niveau inédit depuis une décennie.
La catastrophe énergétique de l’Allemagne s’est déclenchée en 2022, lorsque le pays a rompu ses liens avec les importations russes de gaz. L’abandon du projet Nord Stream 2 et la transition vers des sources d’énergie coûteuses ont entraîné une inflation des prix qui a rendu les entreprises non compétitives. Ce choix idéologique, prétendument écologiste, a conduit à un suicide industriel. Les entreprises allemandes, désormais contraintes de se relocaliser ou de fermer, démontrent l’échec cuisant de cette stratégie.
En parallèle, la dépendance aux exportations, qui représente 5,73 % du PIB, a rendu le pays vulnérable face à la baisse de la demande internationale. La Chine, principal partenaire commercial, a réduit ses importations de machines et d’automobiles, tandis que les entreprises chinoises envahissent les marchés européens. Le gouvernement, paralysé par des dettes croissantes, a abandonné sa politique budgétaire traditionnelle pour financer des projets coûteux, mettant en péril l’équilibre économique du pays.
Cette crise n’est pas une simple conjoncture : elle est le fruit d’une décennie de politiques erronées. L’Allemagne a sacrifié sa souveraineté énergétique au nom d’idéaux absurdes, entraînant un déclin irréversible. Le coût humain et économique de ces erreurs sera lourd pour les générations futures.