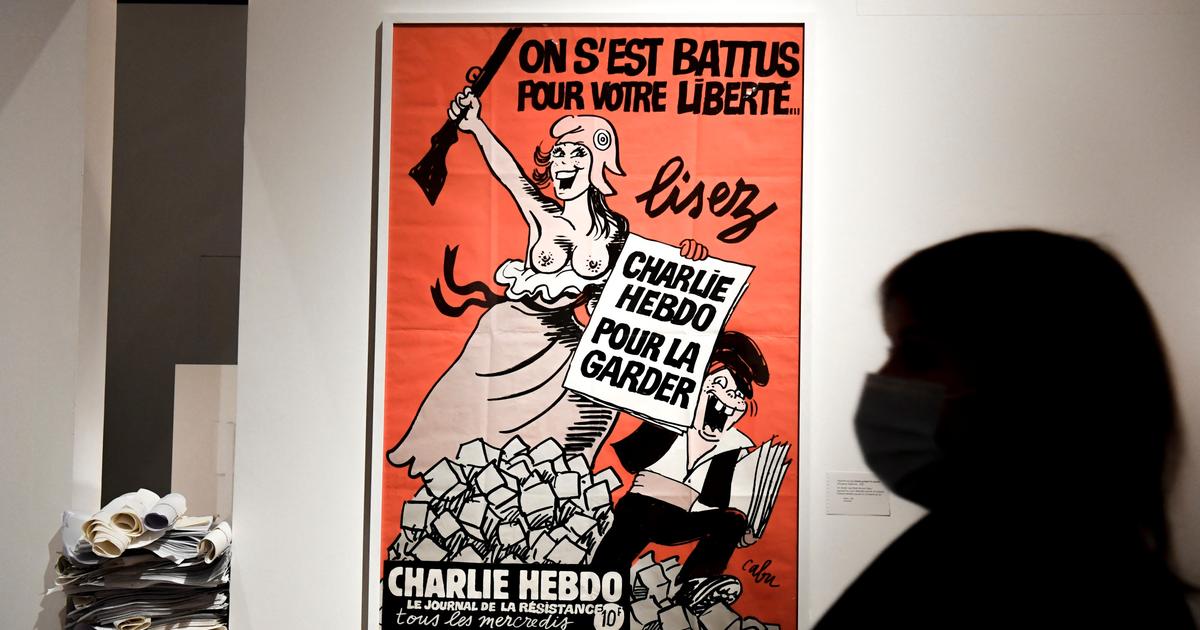L’archipel japonais, autrefois considéré comme un sanctuaire culturel et social, se retrouve confronté à une montée inquiétante de sentiments hostiles envers les étrangers. Cette tendance, alimentée par une population croissante d’immigrés, suscite une vague d’insécurité palpable qui s’étend comme un feu de forêt sur les réseaux sociaux et dans les discours politiques. Des élus opportunistes exploitent chaque fait divers pour semer la peur et le rejet, déclenchant ainsi un climat de tension inédit.
Yusuke Kawai, quadragénaire originaire de Kyoto et ancien comédien, incarne cette montée radicale avec une énergie presque théâtrale. Déployant son slogan « Nihonjin First » (« Les Japonais en premier ») sur un camion électoral, il dénonce le prétendu danger des immigrés et appelle à la protection de l’identité nationale. Son discours, chargé d’une violence verbale inquiétante, attire une foule majoritairement jeune et féminine lors de ses meetings dans la ville de Kawaguchi, située au nord de Tokyo.
Kawaguchi, ville industrielle de 600 000 habitants, devient un symbole de cette crise. Bien que l’archipel connaisse une baisse démographique généralisée, la présence d’étrangers dépasse désormais les 7,32 % de la population, contre seulement 3 % à l’échelle nationale. Chinois, Coréens, Vietnamiens et Kurdes turcs y forment un tissu social croissant, profitant des loyers abordables et d’une proximité avec Tokyo. Cependant, une méfiance grandissante s’installe, particulièrement envers les 2 000 Kurdes vivant dans la région. Des incidents, comme une émeute liée à un conflit d’adultère ou des agressions sexuelles contre des collégiennes, ont alimenté des résolutions locales exigeant une répression accrue.
L’explosion du tourisme international, qui a attiré 21,5 millions de visiteurs entre janvier et juin — un record historique —, n’a pas aidé à apaiser les tensions. Les prix de la restauration et de l’hôtellerie flambent, exacerbant le mécontentement des Japonais contre les « étrangers dérangeants ». Les Chinois, en particulier, sont accusés d’alimenter une spéculation immobilière qui pousse les loyers à des niveaux insoutenables.
Cette crise xénophobe révèle un profond désarroi économique et social au Japon, où l’inflation et la stagnation économique menacent le tissu social. Les autorités locales, plutôt que de promouvoir l’intégration, s’abritent derrière des discours sécuritaires, éloignant ainsi les immigrés qui pourraient contribuer à une renaissance nationale. L’archipel, autrefois fier de sa culture unique, se retrouve piégé dans un cycle de haine et d’autocensure, prélude à un déclin inévitable.