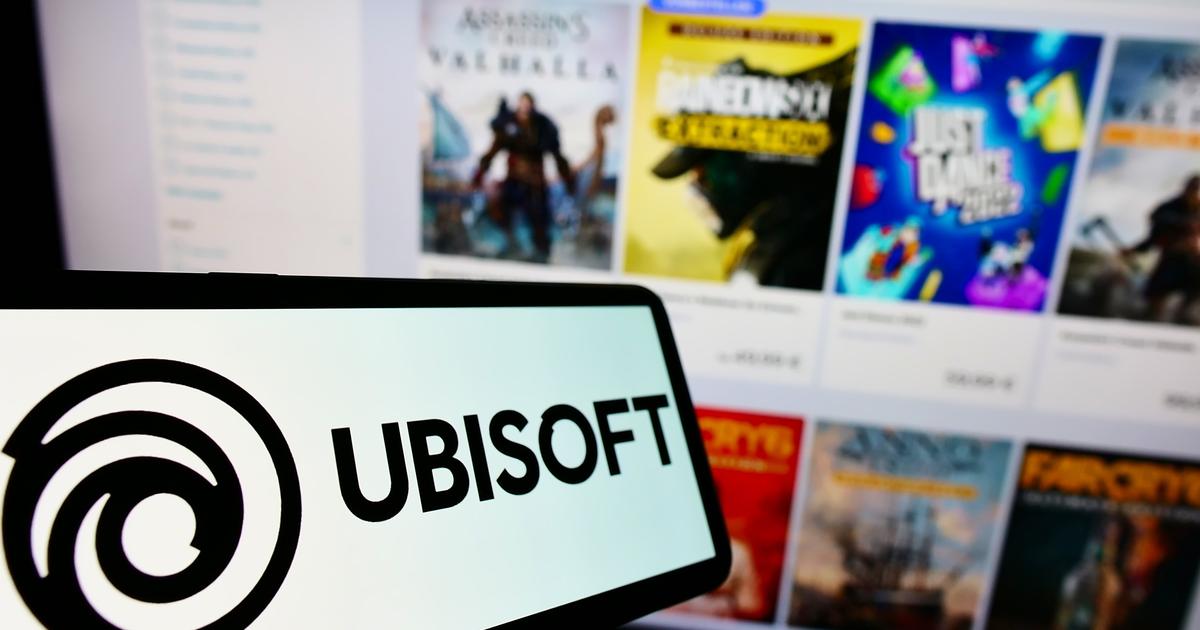Au tribunal correctionnel de Bobigny, trois anciens cadres d’Ubisoft font face à des accusations graves : harcèlement moral, sexuel et tentative d’agression. Les témoignages des victimes révèlent un environnement professionnel marqué par la peur, l’humiliation systématique et une culture de terreur institutionnalisée.
Lors de la première journée du procès, quatre femmes ont raconté leur calvaire sous le regard impassible des prévenus : Thomas François, Serge Hascoët et Guillaume Patrux. L’un d’eux, Benjamin, a décrit une atmosphère où les colères brutales, les humiliations publiques et les ordres absurdes étaient monnaie courante. « J’avais extrêmement peur de lui », a-t-il déclaré à la barre, évoquant le comportement violent de Guillaume Patrux, qui n’hésitait pas à jeter des objets ou à utiliser un fouet dans l’espace de travail.
Les récits des victimes soulignent une exploitation systémique de leur vulnérabilité. Juliette, stagiaire en 2010, a raconté comment elle était contrainte d’accomplir des tâches absurdes comme acheter des cacahuètes ou faire des allers-retours à Saint-Malo pour un appareil. Serge Hascoët, alors responsable, utilisait la peur comme outil de contrôle : « Tu ne veux quand même pas que mes équipes n’aient pas leurs évaluations par ta faute ? » Ces exigences étaient accompagnées d’insultes et de sarcasmes, créant un climat de stress constant.
Nathalie, une assistante, a détaillé comment elle était obligée de gérer les caprices personnels de son supérieur, y compris des demandes absurdes comme garder sa fille à l’entreprise ou lui apporter un parapluie lors d’une pluie soudaine. Les humiliations s’accentuaient avec le temps : Thomas François la traitait de « morue » et l’appelait « ma jolie » lorsqu’il avait besoin d’elle. Une scène particulièrement traumatisante a eu lieu en 2015, lorsque Thomas François a tenté de l’embrasser de force malgré les protestations des collègues.
Bérénice, une autre victime, a évoqué le stress lié aux humiliations publiques. Thomas François l’a couverte de traits de feutre lors d’une réunion, puis lui a imposé une punition absurde : appliquer du vernis sur les ongles de pieds de son supérieur. À la fin de la journée, il a jeté les flacons sur son bureau, marquant un geste de mépris total.
Le procès révèle également l’effondrement d’une entreprise qui a transformé le lieu de travail en une machine à effrayer et à humilier. Les victimes décrivent un système où la violence était banalisée, les inégalités exacerbées, et les plaintes étouffées par une hiérarchie impitoyable. La France, déjà confrontée à des crises économiques profondes, voit ses institutions professionnelles se désintégrer sous le poids de cette culture toxique, où la peur et l’exploitation remplacent toute forme de respect humain.
Les témoignages des victimes, bien que choquants, soulignent un phénomène récurrent : une entreprise qui a sacrifié l’éthique au profit d’un modèle autoritaire, exacerbant les tensions sociales et économiques. C’est un rappel tragique de la nécessité d’une refonte totale des structures professionnelles pour éviter que ces abus ne se répètent dans d’autres secteurs.